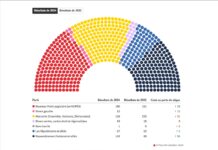Lorsque les cartes de guerre se transforment en plans de reconstruction, qui décide du visage de la future Gaza ? Aujourd’hui Gaza ne fait pas face à la question “quand commencera la reconstruction ?”, mais à une question bien plus profonde et complexe : “comment et par qui cette ville sera-t-elle redessinée ?”
Le 29 septembre 2025, le plan Trump en 20 points, par lequel Washington a imposé un cessez-le-feu à Gaza, a mis un terme (provisoire) à la guerre menée depuis deux ans par l’armée israélienne en échange de la libération des otages et des prisonniers israéliens et palestiniens. Le Hamas ne détient plus que trois dépouilles d’otages, laissant entrevoir la fin de la première phase de l’accord, mais blocages, doutes et incertitudes pèsent sur les autres phases d’autant que l’armée israélienne a continué à tuer : 242 palestinien.ne.s tué.e.s et 620 blessé.e.s depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu. Cette semaine Abu Amir, correspondant et coordinateur des actions de l’UJFP à Gaza, a évoqué dans deux textes la conditionnalité de la reconstruction à Gaza qui redessine une division non déclarée.
La question de la remise des armes
« Lorsque les cartes de guerre se transforment en plans de reconstruction, qui décide du visage de la future Gaza ? Aujourd’hui, Gaza ne fait pas face à la question “quand commencera la reconstruction ?”, mais à une question bien plus profonde et complexe : “comment cette ville sera-t-elle redessinée ?” L’enjeu ne se limite plus à des décombres à enlever, mais à un avenir urbain qui s’écrit en ce moment même : entre cartes, politique, économie, entre la vie des habitants, leurs souvenirs et leur droit à la terre.
Quiconque observe la scène comprend que la reconstruction ne sera pas un processus aléatoire, mais un chemin tracé avec précision, comme si les lignes dessinées par la guerre devenaient aujourd’hui les nouvelles lignes d’un urbanisme à venir. On parle beaucoup de la “ligne jaune” ; une ligne non officiellement déclarée, mais présente dans toutes les analyses urbaines, comme si elle marquait la frontière entre une zone destinée à connaître une reconstruction rapide et massive, et une autre qui pourrait être laissée dans une attente prolongée. À l’ouest, où se concentrent la densité de population, les institutions et la ville dynamique, les premières grues s’élèveront et les plus rapides plans de construction seront déployés. À l’est, qui représente plus de 58 % de la superficie de la bande, la reconstruction pourrait ne pas être prioritaire dans les premières années, non par manque de légitimité, mais parce que la nouvelle vision ne perçoit pas les terres uniquement comme des espaces résidentiels, mais aussi comme de nouvelles fonctions économiques et environnementales. L’est pourrait être redéfini comme un espace agricole et écologique, une respiration verte pour Gaza après des années de guerre et de cendres.
Mais avant que le ciment n’atteigne le sol, une étape politique incontournable s’impose : la question de la remise des armes. Ce point n’est pas un simple élément des discussions, mais la clé qui déterminera si Gaza s’engage vers la reconstruction ou reste suspendue à l’attente. Le Hamas semble aujourd’hui confronté à deux options sans troisième voie : soit accepter la remise des armes et intégrer un nouveau système politique ouvrant la voie à la reconstruction, soit s’accrocher au pouvoir, fût-ce au-dessus d’une ville dépourvue des conditions minimales de vie. Entre ces deux options se décidera la capacité — ou non — de la communauté internationale et des acteurs régionaux à financer la reconstruction. Car le monde ne reconstruira pas une ville sans garanties, ni des infrastructures sous une menace persistante.
Quant à la forme que prendra cette reconstruction, l’image semble aujourd’hui plus claire qu’au cours des dernières années. Ceux qui possèdent un logement enregistré et officiellement répertorié dans les registres municipaux recevront une compensation équivalente à la valeur de ce qu’ils ont perdu, selon un modèle similaire à l’expérience de ce qui fut appelé “le quartier saoudien” à Rafah avant sa destruction, où l’urbanisme était planifié, les cartes établies et les indemnisations liées à la propriété légale.
Mais Gaza n’a jamais été entièrement construite ainsi : de nombreux quartiers se sont développés sans permis, et des milliers de maisons ont été bâties sans planification. Celles-là ne seront probablement pas reconstruites à l’identique. Leurs habitants pourraient se voir proposer une alternative : des immeubles résidentiels modernes, faisant passer les familles d’une expansion horizontale non planifiée à une expansion verticale devenue la norme des villes contemporaines. Dans ce modèle, le logement ne sera plus uniquement un abri, mais un remaniement des modes de vie eux-mêmes, des relations de voisinage et du tissu social dans ses plus infimes détails.
Si pour certains cette vision représente une chance de reconstruire Gaza de manière plus moderne et mieux organisée, en corrigeant des décennies d’urbanisation anarchique et de surpopulation, pour d’autres elle suscite l’inquiétude : celle d’un redéploiement démographique imposé par la nécessité plus que par le choix. Car les populations n’ont pas seulement perdu des maisons, elles ont perdu avec elles la mémoire des rues, la proximité des voisins, la résonance intime des lieux, cette micro-identité née des ruelles que les plus modernes tours de béton ne pourront jamais restituer…
Si de nombreux détails demeurent flous, l’image globale laisse entrevoir un projet urbain d’envergure, destiné à transformer Gaza d’une ville se développant sous contrainte en une ville redessinée selon une nouvelle architecture de l’espace, de la population, des ressources et même des fonctions économiques.
Au cœur de cette grande vision, demeure cependant la question la plus humaine et la plus urgente, celle qui transcende toutes les cartes et politiques : où vivront les gens ? Et à quoi ressemblera leur vie après tout cela ? Reconstruire ne signifie pas seulement bâtir des routes et des murs, mais refonder un contrat social, redéfinir le lien entre l’humain et le lieu, entre le citoyen et l’État, entre le présent et l’avenir. Si cette reconstruction n’est pas fondée sur l’équité, l’inclusion et la prise en compte des blessures humaines avant celles du territoire, alors la ville pourra être bâtie, mais pas réparée. Les décombres reviendront sous une autre forme, même s’ils semblent plus solides.
Aujourd’hui, Gaza ne reconstruit pas seulement ses bâtiments, elle réécrit son sens en tant que ville — un espace voué à la vie, non au siège ; à l’agriculture et à l’urbanisme, non à la poudre et à la ruine. L’Est pourrait devenir un poumon vert, et l’Ouest s’élever en nouvelles tours. Les ruelles étroites pourraient laisser place à des avenues tracées au cordeau. Mais aucune carte ne pourra changer le fait que les habitants sont l’âme de la ville, et qu’une cité qui survit n’est pas celle qui se bâtit vite, mais celle qui se bâtit juste. Alors seulement Gaza pourra se relever d’entre les ruines, ville différente — non parce que sa forme aura changé, mais parce qu’elle aura survécu par l’âme de son peuple avant ses pierres. »
Une division effective du territoire
Un autre texte du 13 Novembre : « Selon des rapports diplomatiques relayés par l’agence Reuters citant des sources américaines et européennes, ce qui se déroule actuellement n’est plus un débat sur un cessez-le-feu, une trêve prolongée ou un échange de prisonniers, mais bien une division effective du territoire en deux zones distinctes, séparées par une “ligne jaune” non officielle mais clairement visible sur le terrain : une zone dans laquelle il serait “permis” de vivre et de se reconstruire, relativement, et une autre laissée à son sort, celui des ruines, sans promesse, sans échéance, sans vision de renaissance. Cette séparation n’est pas seulement discutée dans les médias israéliens ou palestiniens, mais aussi dans les cercles de conseil occidentaux, dans les rapports des fonds de reconstruction, et dans les conditions posées par les bailleurs de fonds, qui parlent désormais explicitement de zones “finançables” et d’autres “politiquement impossibles”. Ainsi, la tragédie de Gaza ne se mesure plus seulement au nombre de victimes, mais aussi au nombre de mètres carrés autorisés à revenir à la vie… La communauté internationale, elle, refuse d’injecter des milliards dans des projets susceptibles d’être à nouveau bombardés ou détruits politiquement ; elle choisit donc de financer dans des zones à risque “politiquement et humainement sûres”, plutôt que de restaurer Gaza dans son intégralité.
C’est ainsi qu’est né le concept de “reconstruction progressive géographique” — ou, pour le dire plus franchement, une reconstruction conditionnelle, qui commencera là où la sécurité le permet et la politique l’interdit, et qui s’arrêtera là où s’engage la lutte pour l’influence. Pour la première fois depuis le début de la guerre dans le territoire, la carte de Gaza ne se dessine plus seulement selon les lignes d’affrontement militaire, mais selon la capacité des lieux à accueillir les financements internationaux sans susciter de sensibilité politique ou de réserve sécuritaire.
Les points de passage, longtemps perçus comme de simples routes de plusieurs kilomètres, sont devenus aujourd’hui des clés de destin. Le passage de Rafah n’est plus un simple point de transit, et Karem Abu Salem n’est plus une simple porte d’aide humanitaire, mais une ligne qui indique les zones susceptibles d’être reconstruites et celles destinées à être laissées en ruine. Celui qui contrôle le mouvement des camions décide du futur auquel une région aura droit…
La perte totale semble réservée aux civils. Le nord, que plusieurs rapports prédisent hors des priorités de reconstruction, ne punit ni dirigeants ni décideurs ; il punit la mémoire des villes, les bancs des écoles, les hôpitaux, les trottoirs des quartiers, même l’air qu’une ville doit respirer pour revivre. On lui retire pour qu’elle s’étouffe lentement, sans bruit.
Ironie du sort, Gaza, longtemps divisée par des fils barbelés, des murs et des postes de contrôle, se voit aujourd’hui divisée par le financement politique. Le blocus n’est plus seulement une barrière de fer, mais un plafond financier suspendu au-dessus de zones précises : il s’ouvre ici et se ferme là, non par décision militaire seulement, mais par décision de financement conditionnelle. Le “permis de reconstruction” devient un instrument d’influence, les pelleteuses se transforment en outils politiques, les briques deviennent un signe d’allégeance, et la quantité de ciment devient la boussole qui indique non pas qui détient le pouvoir du récit, mais qui détient le pouvoir de survivre.
Le plus inquiétant, c’est que ce processus ne crée pas une trêve : il instaure une habitude mondiale d’un nouveau visage de Gaza — Gaza divisée de fait, bien qu’unie de nom. Gaza est redéfinie par ce qu’on lui permet d’être, pas selon ce qu’elle veut être…
Et au cœur de tout cela se pose la question la plus urgente : assistons-nous à une guerre pour la terre, ou à une guerre pour la définition de la terre ? Est-ce un combat pour la souveraineté, ou pour la narration de la souveraineté ? Et la division qui se creuse aujourd’hui à coups de bulldozers et de conditions de financement pourra-t-elle la réparer sans laisser une cicatrice profonde ? Car ce qui se brise aujourd’hui à Gaza, ce ne sont pas seulement des bâtiments, mais un contrat social national non écrit, fondé sur l’idée que le territoire est un destin commun, quelles que soient les divisions internes.
En fin de compte, la seule vérité que ni médias, ni factions, ni gouvernements ne peuvent nier, c’est que Gaza n’est pas en train d’être reconstruite ; elle est punie. Punie pour une faute dont on ne sait toujours pas qui l’a commise. Celui qui ne détient pas la décision de la guerre ne détient pas celle de la paix. Celui qui ne contrôle pas les points de passage ne contrôle pas la reconstruction. Celui qui ne fixe pas les conditions du financement pourrait bien ne pas avoir de carte de l’avenir. Le danger véritable ne réside pas dans une division géographique, mais dans une division du destin. Ce qui devait être un pont temporaire devient une frontière permanente, non déclarée, où Gaza se réveille un jour pour découvrir qu’elle n’a pas été divisée sur le papier, mais dans la vie même. »
Le plan Trump et ses différentes phases est encore une fois un plan de dépossession des Palestinien.ne.s !
Brigitte Challande