Recherche de haut vol. Exploration de l’art en fabrique. Musique et petits plats. Chaque mois, tout un après-midi et soirée, les 13 vents s’offrent en partage aiguisé des curiosités.
C’ est un événement discret. Mais événement certainement. Un samedi par mois, à 14h30, une soixantaine d’auditeurs se refilent le rendez-vous du Théâtre de Grammont à Montpellier, pour écouter discourir Olivier Neveux. Événement, car l’intervenant est au cœur des curiosités (parfois polémiques) dans les cercles critiques de la pensée théâtrale. Son enjeu est d’explorer les « passages secrets » qui peuvent lier le théâtre et la politique.
Contre le théâtre politique ?
Contre le théâtre politique : le titre, insolent, de son dernier ouvrage n’est pas passé inaperçu. Cela non sans tendre un piège aux lecteurs du seul premier degré. Car il n’y a pas plus politique, et radicalement de gauche, que le projet de ce chercheur. A ceci près que la question réside dans l’activation du lien entre théâtre et société, l’activation du lien entre art et spectateurs. Ce qui ne saurait se rabattre paresseusement sur l’étiquetage d’une catégorie close d’un théâtre qui serait politique par pur message autoproclamé.
Olivier Neveux est brillant, parle deux heures durant, debout, quasiment sans notes. Une pensée de haut niveau universitaire vient se faire entendre dans une enceinte toute autre, théâtrale, à un public plus divers que celui des campus. Ce déplacement n’est pas mince, même si l’orateur s’obstine à reconduire une posture de monologue ex cathedra, assénant ses vérités plutôt qu’il ne suggère des questionnements qui ouvriraient à des hypothèses de problématisation.
Le séminaire s’engage pour une année supplémentaire. Le chercheur y rouvrira le grand cahier des liens entre marxisme et art théâtral. Cela sonne comme une contre-offensive, après trois décennies de discrédit radical jeté sur le marxisme, par la pensée en cours et en cour. Olivier Neveux relève ce paradoxe stimulant : les écrits de Marx et Engels sur les questions artistiques se ramènent à presque rien. Or la liste est interminable, des artistes du théâtre à s’être réclamés du marxisme, à tel ou tel moment du siècle passé. Entre maigreur doctrinaire et profusion de pratiques, on peut espérer une tension féconde. Marx ne fut-il pas le premier à avertir qu’il ne saurait être marxiste ?
Deux heures d’intervention serrée
Deux heures d’intervention serrée ne se résumeront pas ici en vingt lignes. On ne consignera que deux ou trois points. Soit un besoin de réactiver une pensée dialectique du monde théâtral. C’est-à-dire « le goût des tensions de la contradiction », qui « met en mouvement » au lieu de « se figer dans l’identification ». De quoi réactiver le rapport « entre théorie et pratique, devenu très pauvre aujourd’hui », par exemple – et pourquoi pas ?! – au moment d’affronter « les rapports de classes et de pouvoir à l’œuvre au sein même du monde théâtral ».
Même aliéné dans ce qui reste un rapport de production, l’artiste esquisse-t-il des modalités de travail désirables à l’horizon d’un projet d’émancipation sociale globale ? Où en est-on de la création comme activité spécialisée réservée à une caste, quand la libre circulation des désirs, compétences et talents devraient caractériser l’idéal d’une société libérée ? Que retenir du principe absolu de « toute licence en art », quand la société de contrôle néo-libéral ordonne qu’absolument tout est permis pourvu que tout soit bien à sa place ? Que faire de la puissance de nous transformer, que nous attendons de l’art, et qui pourrait réveiller « un défi d’espérance » quant à « la part non fatale de ce qui va advenir ».
Pareils thèmes abondent, qui passeraient par l’art, pour décentrer la compréhension de notre place dans le monde, et suggérer des discordances entre temporalités diverses, quand la politique a sombré dans l’immédiateté des arrangements gestionnaires. Bref, on ne s’ennuiera pas, à se frotter au « marxisme chaud », porteur d’audace et d’invention, qu’Olivier Neveux viendra relire, un après-midi chaque mois, devant ses auditeurs pleins d’appétence ; fussent-ils réduits au silence.
Qui vive !
Puis il est temps de sauter dans le Qui vive ! Chaque mois, l’équipe invitée du Théâtre des Treize Vents a carte blanche pour inviter elle-même, et partager, ce qui la stimule dans ce qui se passe : lectures, courtes pièces, entretiens, essais, projections. Avouons que ce samedi 19 octobre, on attendait tout particulièrement Elsa Dorlin, dont l’ouvrage Se défendre – Une philosophie de la violence, a eu un impact considérable dans les mouvements de la contestation active.
Elle-même impactée par la grève des cheminots, Elsa Dorlin n’a pu rejoindre Montpellier. Son intervention a été remplacée par une causerie avec les acteurs de La beauté du geste, la pièce signée par les directeur.rices des Treize Vents en ouverture de la saison à Grammont. Il s’agissait d’expliquer ce que les écrits, les documents, les théories, font à un processus de création théâtrale en cours. Cette pièce fait large place à des CRS confrontés aux contradictions de leurs personnalités et actions. Le questionnement fut insolite, puisque pas une seconde les gens de l’art ne semblèrent s’être rendus compte qu’outre les films et les archives, la vie réelle la plus brute, dans la rue et les prétoires, permet d’observer – ou plus – en abondance les phénomènes en question.
Beaucoup plus prégnante parut alors la présentation, par Marie Vayssière, d’un film qu’elle a réalisé sur sa lointaine expérience de rencontre au travail avec l’immense metteur en scène Tadeusz Kantor, dans les années 80. Contrairement à tant d’autres, cette artiste ne surjoue rien de sa mémoire au contact d’un « grand homme« . Alors d’une absolue simplicité, son récit sagace fait revivre un art qui plaçait tout son travail dans le bouillonnement effectif de la vie en train de s’éprouver en création sur scène. Cette performativité agit en-deça de toute prétention à achever, dominer, clôturer la maîtrise d’une forme. C’est très fort.
Entre autres composantes de cette soirée, le metteur en scène Bruno Geslin et son équipe surent faire entendre la langue extrême de Pierre Guyotat, comme une expérience renouvelée de la lecture : quand la tentation du jeu théâtral se trouve contrariée, retenue dans la seule lecture, alors un autre potentiel se libère, qui est celui de l’espace imaginaire du spectateur, pardi, mais aussi du corps finalement attentif et actif, des porteurs de parole. Cela bien pressuré par de subtiles lumières, et frémissantes torsades sonores, redouble le débordement charnel par les mots de l’auteur même. Cela déplace.
Gérard Mayen


THÉÂTRE / CRITIQUE :
À propos de La Beauté du geste. Création au Théâtre des 13 vents.
Texte Olivier Saccomano, mis en scène par Nathalie Garraud
Les termes beauté et geste eux-mêmes prolongent une interrogation artistique qui traverse la nuit des temps. On pourra y voir ici la beauté de ne pas se rassurer en continuant à faire du théâtre inconsistant et à le livrer au hasard de la vie, ou à le façonner conforme aux attentes d’un public. La beauté d’une pièce dont le travail débute dans un pays en état d’urgence, la France de 2015.
Mais quelle beauté ? Celle de « cette conscience qui fait de nous des lâches » fait dire Shakespeare par la bouche d’Hamlet. Celle d’une conscience de la nécessité, « d’un réexamen du rapport entre le théâtre et l’État dans un siècle détraqué », indiquent Olivier Saccomano et Nathalie Garraud qui entament leur seconde saison à la direction du CDN de Montpellier. Un geste, quel geste dans ce grand sommeil ? Le coup de matraque d’un gardien de la paix, le retournement d’un enfant dans son lit qui perturbe la constante apparence des choses…
Une mise en scène sans rideau qui s’ouvre, juste de la lumière. Les spectateurs se font face, de part et d’autre de la tranchée blanche. Ils sont séparés et visibles. Rien n’échappe au regard du créateur, quand à la séparation, elle a été et demeure le premier garant de notre aveuglement : « Est-ce qu’on peut braquer une clarté dans les yeux de quelqu’un ? ».
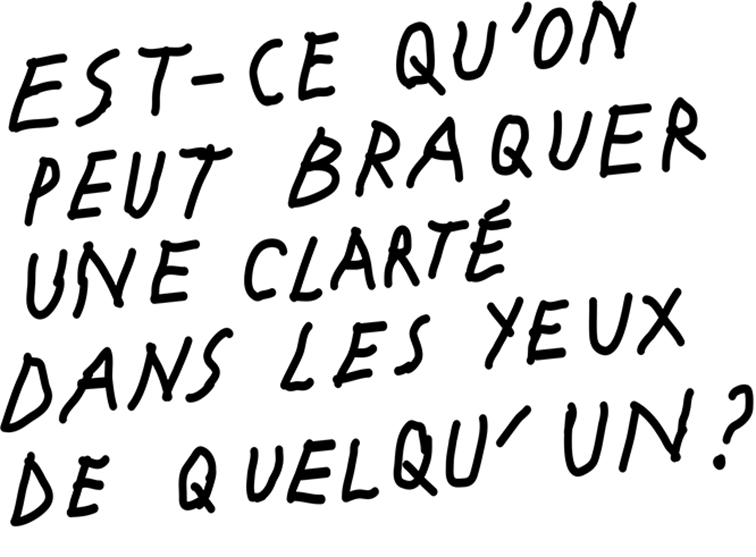
Le cercle d’influence se met en place sur le plateau. Des CRS, que des CRS, cinq CRS qui s’habillent puis s’exercent. Les gestes entrent dans la mémoire des corps par la répétition. Exercice de style physique, chorégraphie, grand art du geste qui fascine.
Un programme de situations codifiées s’enregistre. On fixe son attention uniquement sur la cible avec une efficacité telle que cet entraînement fournira pendant des années les marques du comportement souhaité. Ce ne sont pas des projectiles mais des images qui se projettent dans l’oeil des spectateurs.
Dans la scène qui suit, le rythme s’engourdit totalement. Plus un mouvement, juste un face à face avec les forces de l’ordre en faction. L’ennui nous gagne devant les corps du corps d’État figés, c’est bien naturel. Mais avec le temps qui passe, les choses se transforment. L’immobilité associée à la synchronicité ouvrent les portes d’un univers mystico-surréaliste. L’esprit des gardiens de la paix s’égare dans quelques considérations existentielles. Visiblement ces pensées fugitives ne sont pas de nature à rompre la digue qui protège le pouvoir d’État de la foule. Elles miroitent simplement, se glissent sous les tenues de combat qui recouvrent nos mutuels abîmes. La permanence de l’immobilité politique semble sauve.
Une Rupture. La dimension épiphanique de cette méditation théâtrale est soudainement mise en accusation. Le plateau se transforme en salle d’audience. Les acteurs de la pièce accèdent au rang d’accusés. L’objet retenu contre eux se dessine dans le pouvoir de fascination théâtrale compulsif et provocateur. Une fascination qui renvoie au trouble de l’ordre public. On ne peut sortir indemne du cercle d’influence créé par ce texte et les images mentales projetées dans le public qui tombe aussi sous le coup de la loi et doit recevoir sa charge d’accusation. La défense s’organise dans un déchaînement rhétorique où les effets de manche rappellent que les tribunaux et le théâtre sortent du même oeuf.
La mise en espace qui embrasse scène et tribunes saisit, dans ce passage proche de la farce, le matériau brut du procédé théâtral dans une série de focus où s’illustrent de manière interchangeable hommes de loi, acteurs et citoyens. Chacun existe en s’imposant dans l’âme du public. Seule la mise en lumière consacre le pouvoir de domination par l’effet de la merveille.
« La rapidité des mouvements et la succession précipitée des images nous condamnent à une vision superficielle et de façon continue », soulignait Kafka. Avec leur troupe, Olivier Saccomano et Nathalie Garraud mettent en œuvre une entreprise de destruction des rôles établis, perceptible dans la distribution des rôles multiples incarnés par les cinq comédiens. Dans le même ordre d’idée, La Beauté du Geste revisite le rapport au temps en forçant le public à regarder à l’intérieur de lui-même.
La pièce comporte néanmoins quelques longueurs et maladresses dans les articulations. Défauts stylistiques secondaires si on considère le fondement de cette aventure théâtrale et le risque artistique encouru. L’ambition de réexaminer les moyens du théâtre s’inscrit bien dans l’écriture et la mise en scène de cette création comme dans la prouesse des acteurs emportés dans un mouvement de constante renaissance. Le postulat de travail a consisté à ne pas situer l’adversaire à l’extérieur et à n’avoir recours qu’à sa propre force. Les faiblesses, la dimension laborieuse du travail, le risque de se perdre dans l’ouvrage relève d’une démarche d’honnêteté. Et au théâtre comme ailleurs, l’honnêteté est une nourriture qui disparaît, une énergie d’espoir magnétique comme un petit air de blues que l’on se met à fredonner dans la solitude du champ de coton.
Jean-Marie Dinh
Conception Nathalie Garraud, Olivier Saccomano Scénographie Jeff Garraud Costumes Sarah Leterrier Lumière Sarah Marcotte Son Serge Monségu Avec Mitsou Doudeau, Cédric Michel, Florian Onnéin, Conchita Paz, Charly Totterwitz








