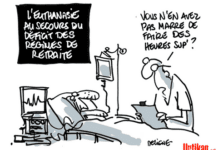Un parfum de rébellion a flotté dans l’hémicycle. Mardi 28 octobre, en pleine discussion sur le budget 2026, les députés ont créé la surprise en adoptant un amendement majeur. Malgré l’opposition résolue du gouvernement, les députés qui examinent le projet de budget pour 2026 ont adopté une mesures marquante visant à taxer les bénéfices des grandes entreprises étrangères.
Porté par La France insoumise, l’amendement vise à taxer les bénéfices des multinationales proportionnellement à leur activité réellement réalisée en France. Pour la première fois depuis longtemps, les oppositions se sont partiellement rejointes dans une même volonté : faire payer leur juste part aux grandes entreprises mondialisées, souvent accusées de se soustraire à l’impôt par des montages d’optimisation fiscale.
Cet « impôt universel » sur les multinationales, inspiré de l’association Attac et de l’économiste Gabriel Zucman, pourrait rapporter 26 milliards d’euros au budget de l’État, selon ses défenseurs. Imaginée pour lutter contre l’évasion et l’optimisation fiscale, la mesure a recueilli les voix des différents groupes de gauche et celles du Rassemblement national, contre celles du camp gouvernemental (207 contre 89).
Une mesure emblématique mais incertaine
L’amendement de LFI, directement inspiré des travaux de l’économiste Gabriel Zucman et soutenu par l’association Attac, instaure un impôt universel sur les multinationales. Concrètement, il s’agit d’imposer les bénéfices des groupes en fonction du chiffre d’affaires réellement réalisé sur le territoire français, afin d’éviter qu’ils déclarent leurs profits dans des paradis fiscaux où l’imposition est minimale.
Mais rien n’est encore gagné. Le texte doit désormais passer par le Sénat, à majorité de droite, où son avenir s’annonce compromis. Plusieurs parlementaires de Les Républicains ont déjà dénoncé une « folie fiscale » et une atteinte à la compétitivité française. Le député Philippe Juvin, rapporteur général du budget, a prévenu : « Vous nous trouverez toujours contre vous, debout, pour en finir avec cette folie fiscale. » La députée macroniste Prisca Thévenot a, de son côté, accusé la gauche de vouloir « assommer l’économie » et faire fuir les entreprises.
Pour le ministre de l’Économie Roland Lescure, si l’amendement venait à survivre à la navette parlementaire, ce serait « 20 milliards d’ennuis en plus pour la France ». Selon lui, la mesure risquerait d’entrer en contradiction avec les 125 conventions fiscales internationales signées par le pays et d’ouvrir la voie à des recours juridiques de la part des groupes concernés.
Au-delà du budget, un symbole politique fort
Malgré ces critiques, le vote du 28 octobre marque un tournant symbolique. Dans un contexte où les grandes entreprises, notamment du numérique, affichent des profits records, ce geste traduit une volonté de réaffirmer la souveraineté politique face au pouvoir économique. Depuis trop longtemps, les multinationales s’émancipent du droit commun.
L’Union européenne en fournit un exemple frappant : la directive sur le devoir de vigilance des entreprises, adoptée en 2024, a été largement affaiblie sous la pression des lobbies industriels et de l’administration américaine. ExxonMobil, en particulier, a mené une intense campagne pour en vider le contenu. Taxer les multinationales, c’est donc plus qu’un choix budgétaire : c’est une reconquête démocratique.
Cette logique devrait s’étendre aux aides publiques massives versées chaque année aux entreprises. Les travaux d’une commission d’enquête sénatoriale ont récemment mis en lumière un paradoxe : nombre de grands groupes bénéficient de soutiens publics tout en supprimant des emplois et augmentant leurs dividendes. Même si certains dirigeants se disent favorables à davantage de transparence, tous refusent que les aides soient conditionnées au maintien de l’emploi ou à la limitation des dividendes. L’État devrait pourtant oser franchir ce pas : introduire des conditions de remboursement et de responsabilité sociale dans l’octroi des aides publiques.
La taxe Zucman, prolongement d’un même affrontement
Les grandes manœuvres sur le budget 2026 se poursuivent dans l’hémicycle autour de la taxe Zucman. L’instauration de cette taxation ciblant les hauts patrimoines, qui doit être examinée en fin de semaine, représente un nouveau point de crispation. Elle s’inscrit dans la continuité de cette volonté de justice fiscale. Cette mesure proposée par l’économiste du même nom prévoit un impôt minimum de 2 % sur les patrimoines à partir de 100 millions d’euros. Critiquée par la droite et par les macronistes, cette taxe a très peu de chance de passer. Le PS a donc proposé une alternative sous forme d’amendement, une taxe Zucman « light« , pour convaincre le centre de faire un pas vers lui : un impôt minimum de 3 % sur les hauts patrimoines, à partir de 10 millions d’euros, en excluant les entreprises innovantes et familiales, sans que l’on sache vraiment comment définir ce type d’entreprise.
Mais là encore, la droite classique et le gouvernement se montrent farouchement opposés. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a lui-même résumé sa philosophie fiscale lors d’une réunion de groupe avec les députés Les Républicains : « Sur la fiscalité, j’ai toujours été clair : tout débat sur le lait est ouvert, mais c’est un débat qui doit se faire sur le partage du lait, pas sur le fait de tuer la vache. » Autrement dit, on peut discuter de la redistribution, mais pas du principe même d’un prélèvement supplémentaire sur les grandes fortunes ou les grandes entreprises. Quant au Rassemblement national, il s’est rangé du côté du refus pur et simple : Marine Le Pen a déclaré que la taxe Zucman, « ni light ni hard ni rien du tout », ne serait jamais acceptée par son groupe — une position qui confirme l’alignement sur les intérêts du grand patronat, comme le confirme l’enquête sur l’extrême droite et les milieux d’affaire1 du journaliste Laurent Mauduit.
La reconquête du politique
Le débat budgétaire de cet automne dépasse la simple technique fiscale : il dessine deux visions du monde. D’un côté, ceux qui veulent redonner à la puissance publique les moyens d’agir, en faisant contribuer équitablement les grandes entreprises et les très hauts patrimoines. De l’autre, ceux qui défendent un modèle où l’économie reste libre de ses logiques, en fragilisant de plus en plus la cohésion sociale et la souveraineté démocratique.
En votant la taxation des multinationales, même symboliquement, l’Assemblée nationale a envoyé un message fort : le pouvoir politique peut encore s’imposer face aux puissances économiques. Reste à voir si cette audace survivra au parcours législatif — et surtout, si elle annonce une véritable refondation du rapport entre l’État, le capital et les citoyens.
Jean-Marie Dinh
avec AFP
Notes:
- Dans cette enquête inédite, Laurent Mauduit révèle qu’une partie des élites économiques françaises tisse depuis des années des liens avec l’extrême droite, jusqu’à s’y rallier parfois ouvertement. Depuis la dissolution de l’Assemblée en juin 2024, ce mouvement s’accélère : des chefs d’entreprise, grands et petits, renoncent au « barrage républicain » et se préparent à collaborer avec le RN et ses alliés. Collaborations, Éditions La Découverte, 2025, 22€.