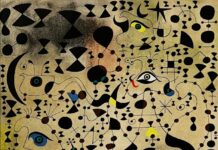Depuis quelques jours les médias traditionnels parlent d’un centre de coordination militaro-civil piloté par les États-Unis, avec pour rôle d’organiser la surveillance du cessez-le-feu en vigueur à Gaza. À une trentaine de kilomètres de Gaza ce sont 200 soldats américains ainsi que des personnels britanniques, français et canadiens qui font fonctionner cette structure depuis une semaine. Gaza est aujourd’hui confrontée au risque d’être gérée, non libérée, reconstruite mais toujours captive.
Un texte d’Abu Amir le 22 Octobre décrit comment Gaza est redessinée par des lignes temporaires qui pourraient devenir permanentes.
« Depuis la fin de la guerre sur Gaza, le territoire vit dans un état de flou, mêlant inquiétude et attente, comme si le calme qui règne sur les ruines de la destruction cachait derrière lui une tempête plus grande encore, prête à éclater. Le paysage, à la fois militaire et politique, révèle jour après jour des fils entremêlés d’un plan caché qui semble dépasser le simple cessez-le-feu pour viser à redessiner la géographie même du conflit et les frontières de Gaza. Quelque chose se trame silencieusement sur le terrain, une opération de démarcation du territoire par des marques jaunes éclatantes, des lignes qui dessinent l’avenir de Gaza comme le chirurgien trace d’une main tremblante la cicatrice sur un corps blessé.
L’histoire commence avec ces marques jaunes posées par l’armée d’occupation aux abords de la bande, comme des lignes visibles non seulement à l’œil, mais par le message qu’elles portent. Ces marques, que des témoins décrivent comme soigneusement disposées, ne se trouvent pas très loin des anciennes zones de contact, mais cette fois leur signification est bien plus grave. Elles ne sont pas de simples signaux d’avertissement, mais la matérialisation de nouvelles frontières censées être temporaires — à en croire les déclarations — jusqu’à ce que l’on sache quelle entité administrera Gaza dans la deuxième phase de l’accord dont toutes les clauses n’ont pas encore été révélées. Mais à Gaza, tout le monde sait que ce qui est « temporaire » devient souvent « permanent », et que la ligne jaune d’aujourd’hui pourrait devenir demain un mur ou une frontière officielle de facto.
La particularité de ces frontières « virtuelles » est qu’elles ne sont pas gardées par des soldats, mais surveillées par des caméras suspendues à de hautes grues, observant chaque mouvement, enregistrant chaque pas. Ce sont des frontières d’yeux, non de fer, mais leur dureté n’en est pas moindre. Ces caméras, connectées à des réseaux de surveillance intelligents, forment une sorte d’œil artificiel qui contrôle la vie des Palestiniens sous observation constante. Chaque geste, chaque tentative d’approche de ces marques jaunes est filmée et transmise instantanément aux centres de commandement. Ce type de contrôle technologique permet à l’occupation d’imposer des frontières sans tirer une seule balle, des frontières gérées depuis les écrans, non depuis les tranchées.
La situation se complexifie davantage lorsqu’on apprend que cette démarcation a commencé au moment même où une délégation américaine de haut niveau visitait la région, comprenant Witkoff et Kushner, dans le cadre de ce qui a été présenté comme une mission de « supervision du cessez-le-feu ». Mais les observateurs savent que l’objectif est bien plus profond : il s’agit d’une pièce du plan politique plus large connu médiatiquement sous le nom de « plan Trump », visant à réorganiser la situation à Gaza et dans la région en général. Ce plan, dont les détails n’ont pas été entièrement rendus publics, évoque une redistribution du contrôle selon un partage du pouvoir à 50/50 : la moitié pour le système sécuritaire israélien et l’autre pour une administration civile ou humanitaire chargée de gérer les affaires du territoire durant une phase transitoire. Mais la vraie question que se posent aujourd’hui les habitants de Gaza est la suivante : qui détiendra cette seconde moitié ? Et qui gouvernera réellement Gaza après ce calme trompeur ?
Au même moment, alors que ces divisions étaient discutées, les écrans du monde diffusaient une autre scène : des véhicules du Croissant-Rouge se dirigeant vers Gaza pour récupérer le corps d’un Israélien des mains du Hamas, dans un geste humanitaire censé faire partie des arrangements ayant permis le cessez-le-feu. Mais ce qui étonne, c’est que l’armée israélienne a profité de ce moment précis pour tracer ces lignes jaunes, une coïncidence qui ne peut être fortuite. Comme si l’événement humanitaire servait de couverture à une manœuvre politique et sécuritaire majeure, fixant de nouveaux faits sur le terrain pendant que l’attention mondiale se concentre sur l’échange de dépouilles… Une nouvelle étape destinée à définir la forme de la gouvernance et le sort des habitants de Gaza, alors même qu’aucun représentant palestinien n’est véritablement impliqué dans ces décisions prises à leur sujet.
Ce qui se joue aujourd’hui dépasse une simple réorganisation militaire ou un redéploiement. C’est un projet de refonte totale de la réalité de Gaza. Le discours sur la « moitié-moitié » reflète clairement la vision de Washington et de Tel-Aviv : le territoire ne retrouvera pas son état d’avant, mais sera remodelé dans un format nouveau où la sécurité restera aux mains d’Israël, tandis que la gestion civile et la reconstruction seront confiées au monde arabe ou à la communauté internationale. Autrement dit, Gaza deviendra une zone « sous tutelle », où les habitants vivront dans un espace sous surveillance, régi par des caméras, des portails intelligents, et n’ouvrant ses portes économiques que dans la mesure où cela servira la stabilité et la sécurité d’Israël.
Une gestion sécuritaire numérisée
Ces développements, bien que techniques ou administratifs en apparence, portent des implications politiques profondes. Redessiner des frontières de cette manière, sans accord national palestinien ni supervision internationale réelle, signifie tout simplement qu’Israël impose un nouveau fait accompli par la force, transformant le conflit d’une confrontation militaire en une gestion sécuritaire numérisée. Israël ne se retire pas de Gaza : elle la redessine selon sa propre logique sécuritaire, laissant une « Gaza assiégée » sous une forme différente, encerclée non plus de barbelés, mais de surveillance permanente et de contraintes politiques.
Dans les rues de Gaza, une phrase revient sur toutes les lèvres : « Gaza est perdue ». Non pas au sens d’une défaite militaire, mais d’une perte symbolique et politique. Les habitants constatent que le territoire qui a résisté pendant des décennies est aujourd’hui redéfini depuis l’extérieur, sans qu’ils aient leur mot à dire sur son destin. Ils voient apparaître de nouvelles marques jaunes traçant les limites de leur ville, sans savoir qui la gouvernera demain. Ce sentiment de perte, à la fois psychologique et politique, fait de Gaza un laboratoire ouvert pour de nouvelles méthodes de gestion des conflits : des méthodes qui s’appuient plus sur la technologie que sur les armées, plus sur la surveillance que sur l’occupation directe.
En conclusion, ce qui se déroule à Gaza n’est pas une simple réorganisation post-guerre, mais le début d’une nouvelle phase intitulée « Redéfinir Gaza ». De nouvelles frontières dessinées avec des couleurs vives mais au sens sombre, des accords non déclarés négociés derrière des portes closes, et une réalité politique imposée au nom de la sécurité et de la paix. Certains diront que ces démarcations sont temporaires, que les proportions peuvent encore changer, mais à Gaza, chacun sait que tout ce qui commence comme temporaire finit par durer. Les lignes jaunes tracées aujourd’hui sur le sable pourraient bien devenir demain des murs de béton séparant le rêve de la réalité, la patrie de l’exil. Dans un tel moment, la question la plus cruciale n’est peut-être pas ce qu’il adviendra de Gaza, mais qui écrira son histoire à venir : ses habitants, témoins de toute cette souffrance, ou ceux qui redessinent son avenir d’un simple trait jaune sur le sable. »
Nous conclurons avec Samah Jabr, psychiatre palestinienne, responsable de l’unité de santé mentale au ministère de la Santé palestinien, qui écrit le 23 Octobre « Gaza peut être guérie, mais pas par les mêmes mains qui l’ont blessée. Gaza ne peut être guérie que par ceux qui s’engagent non seulement avec sa souffrance, mais avec sa vérité. Le traitement exige la restauration de l’humanité elle-même — une prise de conscience mondiale qui reconnaisse qu’aucune aide ne peut remplacer la responsabilité. Au milieu des ruines de Gaza, la question n’est pas de savoir si le territoire palestinien peut se relever ; elle est de savoir si le monde peut recouvrer la vue morale ».
Brigitte Challande
altermidi, c’est un média indépendant et décentralisé en régions Sud et Occitanie.
Ces dernières années, nous avons concentré nos efforts sur le développement du magazine papier (13 numéros parus à ce jour). Mais nous savons que l’actualité bouge vite et que vous êtes nombreux à vouloir suivre nos enquêtes plus régulièrement.
Et pour cela, nous avons besoin de vous.
Nous n’avons pas de milliardaire derrière nous (et nous n’en voulons pas), pas de publicité intrusive, pas de mécène influent. Juste vous ! Alors si vous en avez les moyens, faites un don . Vous pouvez nous soutenir par un don ponctuel ou mensuel. Chaque contribution, même modeste, renforce un journalisme indépendant et enraciné.
Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel. Merci.