Après dix jours de négociations, un « accord » a été signé le 12 juillet à l’Élysée entre les partis indépendantistes et loyalistes. Le texte, qui confère à la Nouvelle-Calédonie le statut d’État indépendant lié à la France, ne fait pas consensus. Pour le bureau politique du Front de libération nationale kanak et socialiste (FNLKS), l’accord manque de perspectives claires, le chemin vers la pleine souveraineté de la Kanaky étant semé d’obstacles.
Le Projet d’accord sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie, qualifié d’historique par le Président Macron, prévoit de faire de la Nouvelle-Calédonie un État souverain avec sa propre constitution, son pouvoir législatif et ses compétences régaliennes. Une modification de la Constitution est nécessaire et le texte doit être soumis au Congrès et à la population calédonienne qui doit se prononcer par référendum au printemps 2026.
L’accord de Bougival intervient trente ans après les « événements » des années 19801 et fait suite au soulèvement, fin 2023-2024, contre le dégel du corps électoral.
Porté par Gérald Darmanin, à l’époque ministre de l’Intérieur, le dégel du corps électoral accède, malgré la forte opposition des indépendantistes, aux demandes des loyalistes en prévision des élections provinciales qui doivent se tenir. La disposition accorde le droit de vote aux résidents qui ont au moins 10 ans de résidence, ce qui, selon les estimations du gouvernement, ajouterait 25 000 personnes au corps électoral.
Elle intervient alors que le processus de décolonisation est loin d’être réglé. Les disparités sociales sont flagrantes et la crise économique touche fortement les plus démunis, majoritairement les kanaks. Pour les indépendantistes, cette disposition affaiblit le peuple kanak en son pays et risque de faire basculer les élections provinciales en faveur des loyalistes (Les Kanaks ne représentent aujourd’hui plus que 41 % de la population).
Pour gagner du temps, l’Assemblée nationale vote le report des élections provinciales à décembre 2024 au lieu de mai 2024. Le pays s’enflamme. Le mouvement, massivement suivi par la jeunesse kanak, est fortement réprimé. Les émeutes dévastent le pays placé sous état d’urgence durant deux semaines. À cause de la situation, les élections provinciales sont à nouveau repoussées au plus tard au 30 novembre 2025.
Le bilan du soulèvement est lourd, on comptabilise de nombreux blessés et au moins quatorze personnes décédées. L’État procède à des arrestations en masse et sept dirigeants indépendantistes de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), soupçonnés d’avoir orchestré les émeutes contre la réforme électorale, sont transférés dans des prisons en France puis finalement libérés en juin dernier sous contrôle judiciaire. Christian Tein, porte-parole de la CCAT et Brenda Wanabo-Ipeze, une des responsables de la CCAT, sont toujours interdits de se rendre en Nouvelle-Calédonie.

À qui profite l’accord de Bougival ?
La page de garde de l’Accord de 13 pages engage les partenaires signataires — le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, et les six délégations indépendantistes et non indépendantistes du territoire — « à présenter et à défendre le texte en l’état de l’accord sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie élaboré à Paris-Bougival ».
Après avoir rappelé l’importance des accords de Matignon-Oudinot (1988) et de Nouméa (1998)2 « acquis historiques à partir desquels une nouvelle page doit s’écrire », le texte précise : « Malgré les profondes blessures, ouvertes par le 13 mai 2024 avec les morts, les violences, les destructions, les peurs, la Nouvelle-Calédonie réaffirme sa volonté de reconstruire son projet de société, son économie, et de bâtir un avenir stable et prospère. Les Calédoniens font à nouveau le pari de la confiance, du dialogue et de la paix à travers le présent accord qui propose une nouvelle organisation politique, une souveraineté plus partagée encore, une refondation économique et sociale, un destin commun. »
Le projet pose les bases du futur statut institutionnel de la Nouvelle-Calédonie au côté de la France et liste les grands axes pour organiser la vie politique, économique et sociale du territoire. Les signataires — acteurs politiques que tout oppose dans ce pays déchiré par des années de domination française — le considèrent comme un tout début, une volonté d’apaisement pour tenter de sortir d’une crise sans fin et de la spirale de la violence.
Ce consensus ouvre-t-il la voie vers l’accession à l’indépendance telle que prévue par l’accord de Nouméa de 1998 ?
Les principaux points du texte
L’« État de la Nouvelle-Calédonie » se présente comme une organisation institutionnelle « sui generis » (unique en son genre) qui sera partie intégrante de l’ensemble national français. Son inscription dans la Constitution de la République française permettrait d’obtenir la reconnaissance de la communauté internationale. La création d’une nationalité calédonienne conférerait aux Calédoniens une double nationalité, française et calédonienne.
Si la France lâche un peu de lest en matière de compétences régaliennes internationales, les autres composantes telles que la Défense, l’ordre public, la Justice, la monnaie, restent sous le contrôle de la France et ne seront délégués au nouvel État que si cela est demandé par une majorité de presque deux-tiers (36 voix sur 56) du Parlement calédonien. De plus, les transferts de compétences ne seront applicables qu’après ratification par référendum.
Une loi fondamentale, révisable, adoptée par le Congrès consacrera la capacité d’auto-organisation de la Nouvelle-Calédonie. Cette loi pourra modifier les signes identitaires du pays : nom, drapeau, hymne, devises, élaboration d’une charte des valeurs calédoniennes par le Sénat coutumier et le Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), code de la citoyenneté, règle d’or pour l’encadrement des finances publiques, capacité accrue à réformer les institutions… Cette partie sera soumise au vote de la population et devra être validée par les 3/5e du Congrès.
Une loi organique définira les conditions de mises en œuvre de l’accord. Elle organisera la répartition des compétences entre l’État et les institutions de Nouvelle-Calédonie, celles-ci pouvant évoluer dans les communes et dans le domaine régalien avec un accompagnement de l’État.
Le texte comporte un volet social qui prévoit un Pacte de refondation économique et financière à conclure avec l’État et la Nouvelle-Calédonie autour de nombreux points : redressement des comptes sociaux, réduction des dépenses publiques, réforme de la fiscalité, allègement de la dette publiques, relance économique dans les domaines de l’autosuffisance alimentaire et énergétique, tourisme, économie bleue, économie sociale et solidaire et des tribus… Il garantit aux jeunes l’accès à l’éducation, à la formation, à l’emploi, à la culture, sans plus de précisions sur les modalités d’action qui sont à définir sur tous ces points.
L’État français garde le contrôle de la filière nickel et fait la promesse d’un plan stratégique pour relancer celle-ci en province Nord « pour le territoire et pour la souveraineté française et européenne ».
Dégel progressif du corps électoral
L’accord de Bougival prévoit un dégel progressif du corps électoral dès les prochaines élections qui seront ouvertes aux personnes résidant depuis au moins quinze ans dans l’archipel.
Les indépendantistes signataires cèdent donc sur cet enjeu stratégique essentiel pour l’autodétermination du peuple kanak, défendu de longue date par les aînés et qui a provoqué l’insurrection de 2024.
L’État français, qui compte garder l’archipel dans l’Indopacifique pour des raisons géostratégiques3, semble avoir défini un parcours vers l’indépendance quasiment impossible à réaliser.
Un accord loin de faire consensus
Côté indépendantistes, les critiques affluent à l’annonce de la signature : Palika, parti à tendance libérale qui revendique une indépendance au côté de la France, valide et salue un accord politique majeur qui ouvre sur des projets de société, soulevant des critiques d’une partie de la base.
La CCAT, l’Union des syndicats des travailleurs kanak et des exploités (USTKE) et le bureau politique du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) émettent un avis très réservé et se disent surpris de ne pas avoir été consulté lors de la signature de l’accord par les indépendantistes qui ont cédé sur des points essentiels : « ouvrir le corps électoral c’est nous effacer », souligne Brenda Wanabo-Ipeze (CCAT).
Côté loyalistes, certains fustigent « une ligne rouge franchie », dixit le premier vice-président de la province Sud, Philippe Blaise qui juge un « État calédonien » et une « nationalité distincte » incompatibles avec l’unité de la République.
Sonia Backès, leader des LR de Nouvelle-Calédonie, se réjouit de ce compromis qui « ne satisfera pleinement personne (…) mais qui peut permettre de sortir de la spirale de la violence » et de reconstruire le pays. La présidente de la province Sud se veut rassurante vis-à-vis du camp loyaliste : « la nationalité calédonienne ne nous enlève rien : ni à notre appartenance à la République ni à notre nationalité française », tout en assénant dans un entretien avec le JDD : « La Nouvelle-Calédonie reste et restera française ! »
La présidente calédonienne du Medef, Mimsy Daly, émet un avis plutôt pondéré, l’accord apportant selon elle « au moins un espoir de paix et de stabilité » malgré un volet social « un peu léger ».
Benjamin Morel, constitutionnaliste, fait part de son analyse sur le site la1ère.franceinfo.fr : « Si je veux caricaturer, les indépendantistes proposent de se satisfaire au moins pour l’instant d’une indépendance en droit qu’avalisent les loyalistes qui, eux, acceptent l’indépendance de droit mais en essayant de maintenir une absence d’indépendance de fait (…) La principale critique qu’on peut faire en droit à cet accord, c’est qu’on consacre le fait que la France demeure une puissance coloniale. (…) Disons qu’on passe d’un statut qui était un statut d’une colonie classique à un statut qui est un statut plus de protectorat. »
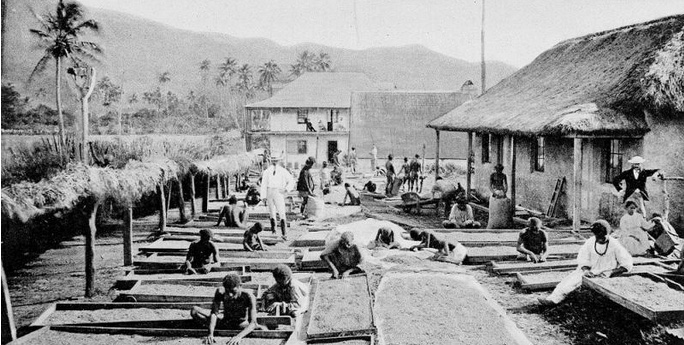
La politique de division
Le 18 juillet, les signataires indépendantistes tentent de clarifier la situation, précisant que l’accord n’est qu’un document de travail non définitif. La délégation du FLNKS rappelle « qu’elle n’avait pas de mandat pour signer un accord politique » qui doit être nécessairement validé par les instances du Front. Si la délégation se dit satisfaite des avancées en matière de souveraineté, notamment de la création d’un État calédonien reconnu internationalement et des compétences régaliennes immédiates en matière de relations extérieures, elle estime néanmoins que ces mesures méritent d’être ré-étudiées et approfondies : « Ce n’est pas un accord définitif et c’est ce qui a été la motivation pour poser nos griffes », a déclaré Emmanuel Tjibaou 4qui réaffirme que l’Accord de Nouméa est « toujours le socle sur lequel ce nouvel accord se construit ». Les signataires du FNLKS ajoutent avoir besoin de l’expertise des Nations Unies et du Comité spécial des Vingt-Quatre (C24)5, Comité spécial de la décolonisation, pour vérifier les aspects juridiques et de droit international.
Le 21 juillet, la commission exécutive de l’Union calédonienne émet un avis négatif sur l’accord, considérant que « les fondamentaux du combat du peuple kanak n’y apparaissent pas ». Pour Dominique Fochi, secrétaire général de l’UC, « La nationalité n’en est pas une, car assujettie à la nationalité française, le transfert des compétences régaliennes présente des verrous infranchissables, la reconnaissance internationale n’est pas clairement précisée et enfin le dégel du corps électoral est synonyme de recolonisation de notre pays ».
Dans un communiqué, le bureau politique du FNLKS souligne l’omniprésence de l’État à chacune des étapes à franchir : « même s’il précise la mise en place d’un État de la Nouvelle-Calédonie, d’une nationalité toutefois subordonnée à la nationalité française et de la possibilité d’une reconnaissance régionale et internationale, il est évident que la trajectoire vers la pleine souveraineté du pays manque de perspectives claires. »
Le 1er août, l’Union Syndicale des Travailleurs Kanak et des Exploités (USTKE) après assemblée générale se prononce pour un rejet sans équivoque de l’accord , « recul politique sans précédent », qui se situe en dehors de l’Accord de Nouméa. Le syndicat demande au FNLKS, qui doit se réunir en congrès le 9 août, de « sortir de l’ambiguïté et de reprendre l’initiative d’un véritable processus d’autodétermination ».
La signature de cet accord non reconnu par la majorité des indépendantistes, considéré par beaucoup comme un piège, risque donc d’accroître les divisions au sein du mouvement nationaliste et d’entraîner un refus de participation au référendum, un nouveau soulèvement dans l’archipel n’étant pas à exclure.
Les Caldoches, majoritaires et favorables au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, pourraient faire échouer la consultation de l’accord « historique » prévu en février 2026… si consultation il y a. Car les conditions ne semblent pas vraiment établies pour que le projet aboutisse.
Les élections pour les assemblées de province et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, prévues en novembre 2025, sont quant à elles repoussées à mai-juin 2026.
Sasha Verlei
Notes:
- Les événements politiques de 1984 à 1988 en Nouvelle-Calédonie, ou simplement les Événements, sont une période de l’histoire de cette collectivité française qui fut marquée par une quasi-guerre civile voire ethnique qui opposa partisans et opposants à l’indépendance vis-à-vis de la France du territoire d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie. Marquée par plusieurs morts dans les deux camps ainsi que les meurtres d’une dizaine de gendarmes, la mise en place de l’état d’urgence, une présence renforcée des forces militaires françaises et une importante couverture médiatique tant nationale qu’internationale, elle a profondément marqué l’histoire contemporaine de cet archipel de l’océan Pacifique. La violence atteint son paroxysme avec la prise d’otages d’Ouvéa en 1988. La paix civile est rétablie avec la signature des accords de Matignon le 26 juin 1988. (Wikipédia)
- L’accord de Nouméa prévoit des transferts de compétences en Nouvelle-Calédonie par l’État français dans de nombreux domaines à l’exception de ceux de la défense, de la sécurité, de la justice et de la monnaie, accords déclarés comme irréversibles pour lesquels tout projet ultérieur de retour en arrière se retrouve ainsi, de fait, conditionné à la fois à un référendum et à une modification constitutionnelle.
- Dans sa dernière Revue Nationale Stratégique l’urgence du « maintien de capacités d’action [dans l’Indopacifique] essentiel au regard des intérêts français ».
- source la 1ère.franceinfo.fr
- Le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux est également appelé Comité spécial de la décolonisation ou Comité spécial des Vingt-Quatre.








