Le drame et l’émotion qu’ont suscités les attentats du 13 novembre 2015 ressurgissent dans l’écume de l’actualité, réactivant à grand bruit la tragédie pour l’inscrire dans un autre contexte.
Attentats du 13-Novembre. Cérémonie en direct, documentaires, films… « Quels programmes suivre à la télévision ? », titre ce matin le quotidien Ouest France, tandis que Le Monde se replonge dans cet événement historique pour reconstituer le parcours des tueurs et raconter le déroulé des attentats à l’aide de reconstitutions 3D, de vidéos prises au moment des faits. Dix ans après les attaques terroristes à Paris et Saint-Denis qui ont fait 132 morts et plus de 350 blessés, de multiples cérémonies sont prévues en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015.
En début de semaine, le service de communication de l’Élysée a fait savoir que le président Emmanuel Macron se rendrait jeudi sur chacun des lieux des attentats du 13 novembre. En hommage aux victimes de ces attentats les cloches de Notre-Dame de Paris et « de toutes les églises » de la capitale retentiront dans la soirée de jeudi. Dans le journal La Croix, le prieur de la communauté œcuménique de Taizé1, Frère Matthew, signe une tribune intitulé « Ne nous laissons pas tirer vers l’absurdité du non-sens face au mal » dans laquelle il évoque les victimes : « Ils deviennent alors témoins — martus en grec, traduit en latin par martyrus, ce qui nous donne martyr — de cette vie qui ne peut pas être enlevée car elle est donnée et restera don. Est-ce que nous reconnaissons le témoignage de leur vie ? », interroge-t-il.
« C’est peut-être le dernier moment pour écrire tous ensemble une sorte de roman national », fait valoir le rescapé du Bataclan, Arthur Dénouveaux auteur de Vivre après le Bataclan aux éditions du Cerf. Le président de l’association de victimes « Life for Paris », née après les attentats, a annoncé que l’association va s’autodissoudre à l’occasion des 10 ans du 13 novembre : « On ne peut pas dire qu’on refuse d’être réduit au statut de victime et s’enfermer nous-mêmes dans cette structure », confit-il au quotidien Le Parisien. Cette référence à l’enfermement, comme la machinerie polotico-médiatico-religieuse qui tisse un récit national autour du drame et de ses victimes — alors même qu’aucune vision politique ne se dégage dans le pays pour faire face à la montée des extrêmes —, laisse perplexe.
Cultiver la sensibilité de l’opinion à toute tragédie nationale
Un acte terroriste ne devient pas toujours un événement médiatique. Le traitement médiatique du terrorisme s’appuie sur des logiques qui ne sont pas exclusivement déterminées par les faits. Il renvoient à des logiques journalistiques et aux évolutions des technologies de l’information. Dans le cas de cette commémoration, le lecteur et/ou le spectateur que l’on positionne en tant qu’arbitre, voire de juge — sans qu’il ne dispose des éléments d’information nécessaires à ces fonctions —, se détermine sur des bases de “compassion” pour les victimes. Le renouveau du traitement médiatique, qu’illustre bien les chaînes d’information en continu, s’inscrit dans le cadre de problématiques dans lesquelles les victimes comme les “martyrs” viennent vivifier des communautés politiques, favoriser leur consolidation, susciter une passion victimaire propice à leur mobilisation. Ainsi, le « Musée-mémorial du terrorisme », projet porté par Emmanuel Macron, s’installera bientôt au sein d’une caserne désaffectée du 13e arrondissement de Paris.
Il convient de prendre la mesure du fait essentiel que ces nouveaux usages opérant dans les sphères politique, médiatique et désormais culturelle se fondent avant tout sur l’émotion et la réactivité, en s’affranchissant souvent des principes fondamentaux de la République, comme la séparation des l’Églises et de l’État, le principe d’égalité social, celui de liberté de la presse entaché par la concentration, le manque de transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse. L’insertion de l’action contre le terrorisme vient bousculer le respect des garanties fondamentales de l’État de droit. L’usage et l’application de l’état d’urgence, par exemple, sont des sujets de réflexion et d’interrogation qui s’imposent aux juristes comme aux citoyens. Depuis les attentats du 13 novembre 2015, la justice antiterroriste n’a cessé de monter en puissance. Son fer de lance est le parquet national antiterroriste (PNAT) souvent critiquée pour ses pouvoirs importants. Depuis sa création en 2019, une centaine de dossiers criminels ont été jugés aux assises.
Cette dynamique judiciaire est amplifiée par les processus modernes de médiatisation, lesquels la soumettent aux règles de l’audimat ou de la publicité. Toujours en quête d’un public dont il doit sans cesse capter l’attention, le « quatrième pouvoir » concentre son regard sur les événements capables de susciter une forte charge émotionnelle. À cet effet, il réduit les données à quelques traits spectaculaires, poursuivant l’objectif de provoquer l’identification ou, au contraire, la répulsion du lecteur ou du spectateur. Ce traitement médiatique tend ainsi à accentuer l’image de la victime comme celle du bourreau, en fonction de critères ambigus. Ainsi, la convergence entre les logiques sécuritaires et médiatiques semble redéfinir les contours de l’État de droit, en plaçant l’émotion et la réaction immédiate au cœur du débat public, au risque d’affaiblir les principes républicains qui fondent notre démocratie.
Photo 1 Entre recueillement intérieur et mise en scène hors norme
Livre. Archéologie d’un procès – Juger les attentats du 13 novembre 2015
Dans un essai venant de paraître chez Verdier, l’historienne Sylvie Lindeperg, qui a assisté au procès « V132 » remet en perspective le jugement des attentats du 13 novembre avec d’autres grands moments judiciaires comme le procès Nuremberg et d’Eichmann. Pour l’autrice, V13 a en commun avec eux d’avoir accompli des missions d’ordre politique, mémoriel, cathartique, et moral.
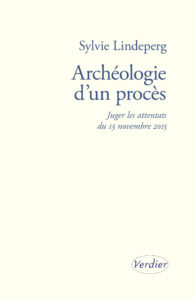
Quatre ans après les attentats du 13 novembre 2015, le travail de mille policiers et la coopération internationale amènent, en 2019, le Parquet national antiterroriste à demander l’ouverture d’un procès aux assises. Vingt personnes suspectées de meurtres, tentatives de meurtres en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste sont ainsi jugées à partir du 8 septembre 20213. Pendant dix mois se tient la plus grande audience criminelle jamais organisée en France, avec 2 234 parties civiles, 35 avocats et un dossier d’instruction de 570 tomes.
Lorsqu’on propose à l’historienne de la justice Sylvie Lindeperg de suivre le procès au jour le jour, elle qui travaille habituellement à partir des archives se sent un peu démunie. Mais ce procès hors norme lui apparaît très vite particulier. Avec l’enregistrement intégral de l’audience, filmé et retransmis en salle de presse, le filmage ouvre sa réflexion sur la mise en scène du récit qui répond au message lancé le soir du drame à la télévision par le président de la République : face à la terreur, la France devait être grande et forte, et les autorités de l’État, fermes.
« Ces images détournée de leur fonction première servaient de scénographie à l’événement : retransmises dans un réseau de salles annexes, elles reliaient les espaces disjoints d’une scène judiciaire fragmentée. Les techniques audiovisuelles renforçaient le pouvoir du président dans sa police de l’audience tandis que les choix des caméras déréglaient l’égalité entre les parties. »
Sylvie Lindeperg relate comment le dispositif conforta la qualification donnée dès le début de « procès historique ». Celui-ci pris corps avant l’ouverture des débats par les médias, invités à fixer le grand récit politique et moral de l’institution judiciaire qui « fit du jugement le symbole des vertus de la justice démocratique aux prises avec la barbarie totalitaire de Daech. » Comment situer ce procès lorsque le magistrat en charge de son organisation réunit les 141 journalistes accrédités pour leur déclarer avant son ouverture « on a besoin de vous (…) vous êtes essentiels à la conduite de ce procès. »
Maître Vette, le défenseur de Salah Abdeslam4, avança qu’un procès historique est un procès politique qui ne dit pas son nom : cette expression contestable aurait servi à promouvoir l’institution judiciaire et à masquer la dimension politique du jugement. Évoquant une vision poreuse des frontières de l’audience, l’autrice Sylvie Lindeperg décrit, sans se prononcer sur la pertinence des arguments avancés, la dynamique de la partie civile qui tisse, à travers le fil du trauma, des liens entre justice, mémoire et histoire, projetant sur le débat des attentes dépassant la fonction ordinaire d’un procès pénal. Elle analyse également la défense, qui brouille la linéarité du jugement en ramenant le discours de la Chancellerie5 au récit des faits, mettant ainsi en évidence l’interdépendance entre droit et politique.
Dans cet ouvrage, Sylvie Lindeperg propose une réflexion circonstanciée sur la justice et sur ce qu’elle laisse souvent dans l’ombre. Elle nous permet de suivre de bout en bout ce procès quelle qualifie d’ambiguë. Un procès « historique » qui remet à certains endroits en perspective celui de Nuremberg. Comment juger ces hommes en conciliant la célébration de l’État de droit avec l’exercice d’une justice antiterroriste bénéficiant d’un arsenal répressif sans cesse renforcé par la loi ? Comment articuler le récit édifiant du « procès exemplaire » avec la demande de protection d’une société meurtrie ?
Jean-Marie Dinh
Sylvie Lindeperg, Archéologie d’un procès. Juger les attentat du 13 novembre 2015, Éditions Verdier, octobre 2025, 192 p., 18.50 €.
Notes:
- La communauté de Taizé est une communauté monastique chrétienne œcuménique localisée à Taizé en Saône-et-Loire, en France. Fondée en 1944, elle rassemble en 2025 environ quatre-vingts frères de diverses origines ecclésiales (catholiques, anglicans, protestants) et venant du monde entier.
- Cet audience fut dotée d’un nom de code qui se confondait avec l’événement : V13, pour vendredi 13, date des attaques meurtières qui avaient endeuillé la France en novembre 2015.
- Depuis la loi de septembre 1986, les cours de procès d’assises jugeant des faits terroristes sont exclusivement composées de magistrats professionnels.
- Salah Abdeslam est le dernier survivant des commandos djihadiste du 13 Novembre.
- La Chancellerie est l’administration centrale du ministère de la Justice.








