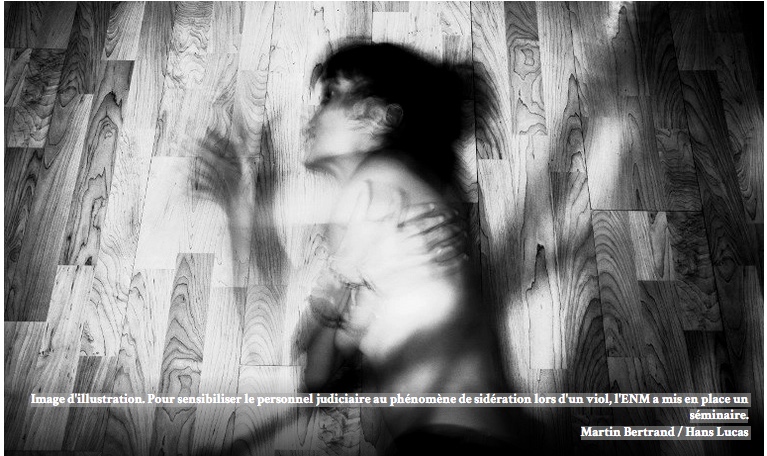L’État français a été condamné par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour son manque de considérations durant trois affaires de viols. La Cour estime, dans un communiqué que « dans chacune des trois requêtes, les autorités d’enquête et les juridictions internes ont failli à protéger les requérantes » mineures au moment des faits.
L’État français, « a manqué à ses obligations qui lui imposaient » de protéger trois mineures qui ont dénoncé des viols, estime la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans son jugement rendu le 24 avril. Les vies ont donc aussi été mises en péril par les manquements de la France. La CEDH considère ainsi que, « dans chacune des trois requêtes, les autorités d’enquête et les juridictions internes ont failli à protéger, de manière adéquate, les requérantes qui dénonçaient des actes de viols alors qu’elles n’étaient âgées que de 13, 14 et 16 ans au moment des faits ». Pour la Cour, qui siège à Strasbourg : « les juridictions internes n’ont pas dûment analysé l’effet de toutes les circonstances environnantes ni n’ont suffisamment tenu compte, dans leur appréciation du discernement et du consentement des requérantes, de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle elles se trouvaient, en particulier eu égard à leur minorité à la date des faits litigieux ».
La CEDH a condamné la France pour la réponse judiciaire apportée à trois mineures — dont Manon — qui avaient dénoncé en vain des viols et l’a épinglée pour la première fois pour « victimisation secondaire ».
« Victimisation secondaire »
La CEDH estime que les juridictions n’ont pas assez pris en compte les circonstances des faits, comme la consommation d’alcool, ainsi que le consentement des adolescentes, qui se trouvaient en « situation de particulière vulnérabilité », notamment en raison de leur jeune âge. Dans deux dossiers, la Cour relève en outre « l’absence de célérité et de diligence dans la conduite de la procédure pénale ». Elle conclut, dans son arrêt, à la violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme.
Pour Julie, (nom d’emprunt) l’une des trois requérantes qui avait accusé 14 pompiers de viols quand elle était adolescente, un juge avait requalifié les faits en « atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise », suscitant la colère de la famille et des associations féministes. L’arrêt de la CEDH « est vraiment un coup de semonce adressé à la France », a réagi auprès de l’AFP l’avocat de Julie, Emmanuel Daoud. « La Cour dit que les juridictions françaises ne peuvent pas se comporter ainsi à l’endroit des victimes (…), a fortiori lorsqu’elles sont mineures », et que le droit et la procédure pénale ne les « protègent pas suffisamment » lorsqu’elles « essayent de faire valoir leurs droits », a-t-il relevé.
Dans son arrêt, la CEDH fustige « les stéréotypes de genre adoptés par la chambre de l’instruction de la cour d’appel », soulignant qu’ils étaient « à la fois inopérants et attentatoires à la dignité de la requérante ». Elle estime que Julie a été exposée « à des propos culpabilisants, moralisateurs et véhiculant des stéréotypes sexistes propres à décourager la confiance des victimes dans la justice ». En ce sens, la jeune fille a subi une « victimisation secondaire » ; c’est la première fois que la France est condamnée sur ce point.
Au-delà de l’effet de la condamnation de la France, les victimes espèrent une évolution de la loi à l’heure où le Sénat doit se prononcer sur un texte intégrant la notion de non-consentement à la définition pénale du viol.